"Lol V. Stein, c'est moi"
- jmdevesa
- 20 oct. 2025
- 13 min de lecture
Ma collègue Marie-Lise Paoli a eu la très grande gentillesse de me convier au colloque internation qu'elle a organisé à Bordeaux à l'occasion du 40e anniversaire de la fondation de l'ERCIF (le centre qui à Bordeaux 3 puis à Bordeaux Montaigne s'est consacré à l'étude des écritures et des imaginaires des femmes).
Cette manifestation s'est déroulée du ! au 10 octobre 2025.
J'y ai été invité pour deux interventions : le 8, au soir, au Palais Rohan-Mairie de Bordeaux pour une présentation-lecture de mon roman "Une désarmée des morts" (Le Temps des Cerises, 2025) et le 9, pour une communication ayant trait à Marguerite Duras et à son personnage Lol V. Stein.
Je me permets ce jour de mettre en ligne le texte de ce propos plus littéraire qu'académique... Je vous en souhaite une agréable lecture.
"Lol V. Stein, c’est moi…
Je suis infiniment reconnaissant à Marie-Lise Paoli d’avoir il y a quelques mois accepté les axes et la tonalité d’une communication qui, par son titre, passablement baroque, et singeant les grands ancêtres, ne présageait pas nécessairement un propos très sérieux, même si vous m’accorderez d’avoir évité le pire en ne retenant pas un calamiteux « Lol, c’est moi ». À l’époque, indépendamment du précédent illustre de Gustave Flaubert déclarant que Madame Bovary c’était lui, il m’était apparu qu’il me faudrait, ce jour, assumer cette assertion, « Lol V. Stein, c’est moi », pour déplier davantage en écrivain qu’en universitaire deux ou trois choses me tenant à cœur de ce roman et de ce qu’il suscite chez moi. Voilà pourquoi, aujourd’hui, devant vous, pour parler du Ravissement de Lol V. Stein, je le ferai à la manière de Marguerite Duras saluant Robert Bresson, je me livrerai à « cette critique-là : ne pas parler du roman de façon intemporelle mais de moi devant lui[1] »…
Je suis bien évidemment conscient de l’imprudence à laquelle j’ai cédé en proposant pareil intitulé, lequel induit plusieurs risques : celui d’abord de donner l’impression de souffrir d’une hypertrophie du moi ; celui ensuite de me laisser aller à une appropriation sans scrupule de la lumière d’une autre – et ici sous l’auspice de sa créature –, et pas de n’importe quelle autre, puisque c’est de Marguerite Duras dont il s’agit ; et enfin à celui de me complaire dans une énorme et épouvantable imposture en substituant ma parole à celle d’un personnage féminin, Lol V. Stein, et en la ventriloquant donc outrageusement.
Naturellement, il me faudra convaincre que je ne suis pas tombé dans ces ornières et que je demeure en alerte pour ne pas y verser. Toutefois, à ce stade de ma réflexion, j’ai l’impression que si je réussis à établir que je suis loin d’être affecté par le dernier des trois travers évoqués je n’aurai plus besoin de ferrailler pour m’exonérer des deux premiers.
Le rapport existentiel que j’entretiens avec Duras et sa Lol V. Stein (sur lequel je m’expliquerai dans quelques instants) m’interdit d’attribuer ma possible cécité et surdité à la lettre et à la voix de l’écrivaine au sexe et au genre dans lesquels je me reconnais, d’autant que ma pensée en ce domaine est moderne, et non pas contemporaine, étrangère à la taxinomie identitaire qui s’est imposée depuis dix ou quinze ans elle résulte en effet d’un « bricolage » (lévi-straussien) de Sigmund Freud, de Jacques Lacan, de Gilles Deleuze et de Félix Guattari, si bien que je me parle en termes de devenir et de bisexualité psychique, dans une singularité radicale et souveraine en voisinage avec celle des autres, ce qui autorise les unes et les autres, les uns et les autres, à percevoir chacune et chacun dans une commune humanité[2].
Marguerite Duras ayant retenu un dispositif narratif qui prête à Jacques Hold le soin de conter l’histoire de Lol V. Stein, à partir de ce qu’il sait d’elle, soit qu’elle le lui ait fourni, soit qu’il l’ait recueilli auprès de Tatiana, et en fonction de ce qu’il en invente, cet agencement me suggère que, dans l’esprit de la romancière, il n’était pas forcément rédhibitoire d’être un garçon, quand on s’essayait à relater et à reconstituer une trajectoire féminine, et qu’on s’appliquait à la comprendre : s’il en avait été autrement, pourquoi aurait-elle déployé pareille diégèse ?
Parmi vous, je n’apprendrai à personne que Duras a été lue par Jacques Lacan, qui y avait été encouragé par Michèle Montrelay, ce qui nous a valu une étude importante, je songe au fameux « Hommage à Marguerite Duras du Ravissement de Lol V. Stein[3] » (1965), dans laquelle le psychanalyste estime que, dans son texte, l’autrice a « couché » un enseignement indépendamment de ce que lui, Lacan, était censé enseigner et donc savoir. De cet éloge de Duras par Lacan et de mon propre parcours dans Le Ravissement de Lol V. Stein, et en me fondant sur mes multiples tâtonnements, les livresques et les interpersonnels qui ont jalonné ma route, j’extrapole que les deux ou trois connaissances que, quelquefois, et sous certaines conditions, les garçons réunissent sur les filles, ce sont elles qui les leur transmettent, et quasiment à leur insu, ainsi qu’un échange entre Tatiana et Jacques Hold le suggère (« Comment savez-vous ces choses-là sur Lol ?’ /Elle veut dire : comment les savez-vous à la place d’une femme ? à la place d’une femme qui pourrait être Lol ?[4] »), cette « édification » s’effectuant en des circonstances rares où les sujets en présence ne cillent pas devant l’insoutenable, lequel est d’ordinaire esquivé, puisque pour la plupart nous détournons le regard de ce qui nous sidère et nous excluons de notre champ de vision – nous en faisons un obscène – tout ce qui est susceptible de nous méduser.
Ne déversant jamais ses tourments dans ses textes (ou dans son cinéma), Duras en fait plutôt la matière d’une histoire qu’elle écrit (et filme) en contrepoint du choc majeur provoqué dans sa sensibilité, et pour sa génération, par Die Endlösung der Judenfrage, le génocide des juifs perpétré par le IIIe Reich nazi. En fait, ce qui résonne dans les histoires écrites (et filmées) par elle, c’est la fin de tout un monde, son effondrement sous l’effet de ses propres contradictions et la nécessité de sa destruction totale et entière. Si on a en tête cet arrière-plan, celui par exemple de Détruire dit-elle (1967), est-il encore possible de railler Duras (qui pourtant se nourrit de son roman familial) en l’accusant de narcissisme, de nombrilisme, de complaisance envers les tourments de la petite bourgeoisie intellectuelle parisienne ? Mais à la différence de bien des textes dits autofictifs ou revendiqués comme tels, ses livres ancrent l’intime dans l’Histoire, pas de façon testimoniale ni documentaire, mais dans un registre scripturaire qui refuse d’imiter la réalité, ou de la restituer, et qui par le biais des « vérités menteuses » qu’il (sou)lève charrie de celle-ci – la réalité – des bribes du réel (de ce réel que Jacques Lacan définit en le distinguant du symbolique et de l’imaginaire). Se méfiant des effets pervers de la représentation, tant pour ce qui est de la restitution de l’intime que pour la peinture de l’Histoire, Duras traite par conséquent le récit comme une fiction bravant toute narration réaliste, vériste, exacte, objective, aussi le recrée-t-elle de ses souvenirs, et des oublis et des absences qui trouent ceux-ci… Duras est, à mon sens, une écrivaine de la mémoire qui se perd : l’image mentale que l’on a d’une personne, d’une situation, d’un événement s’effaçant inéluctablement, s’éteignant, s’étiolant de manière que seulement des voix, une voix, persiste(nt), à notre oreille, à notre conscience, nous donnant rendez-vous avec nos fantômes, avec les spectres des milliers de nos semblables qui nous ont précédés et/ou que nous avons croisés, et qui équarris, réduits en cendres, à peine traces, sur le sable de l’Histoire, tous menacés par le vent de l’oubli, « le massacre de l’oubli » pour m’exprimer comme Duras, nous agissent, en affleurant dans nos actes et réalisations, et toujours en les orientant.
À l’automne 2024, j’ai déjà eu à confesser, je le rappelle, que j’associe l’immense Marguerite Duras, la « tchékiste » chère à Jacques Audiberti, à la tractoriste fantasmatique et chimérique dont j’ai toujours voulu être l’amant[5] et que je me suis souvent imaginée en me récitant des vers de Louis Aragon (Il s’échappa du serre-tête une mèche de cheveux blonds /Grande fille couleur de pierre au fond de la pile d’un pont /Qui creusait la boue et le fleuve Elle s’arrête elle s’étonne / De tant de gens sur le chantier Ô Dnieproguess ô pluie d’automne /Ô grand barrage d’espérance et devant l’ennemi demain /Tant de courage et tant de peine il sautera des mêmes mains[6]), lesquels vers aiguisent désormais ma névrose et mon imagination, et mon potentiel de créativité, si j’en ai un, tant ils m’affectent personnellement et pour ce qui est de l’Histoire et de la politique que dans les douleurs d’amour je me suis à tort ou à raison, et probablement bien plus fréquemment à tort qu’à raison, mille fois identifié à Lol V. Stein, confrontée et médusée un soir de bal au Casino de T. Beach quand une inconnue lui ravit son fiancé Michael Richardson, et plus tard lorsque, revenue à S. Thala mariée à un musicien, depuis le milieu d’un champ de seigle, elle scrute subjuguée et magnétisée ce qui se joue et trame entre Jacques Hold et Tatiana Karl, son amie d’école.
Voilà pourquoi je n’ai pas le sentiment, en parlant et en écrivant autour de Duras, de Lol V. Stein, de l’amour, du jouir et de la jouissance, de m’aventurer illégitimement à une exploration – problématique et périlleuse – de ces « territoires ».
De Lol, Duras a dit qu’elle était « sa petite folle » et que plusieurs de ses textes portaient la trace de son influence sur elle, même si elle l’avait « trahie » au profit de et avec Anne-Marie Stretter dont mon collègue Claude Burgelin a affirmé qu’elle cristallisait l’ombre d’Alice Rivière, la première épouse de Henri (Émile) Donnadieu, le père de Marguerite, décédée à l’âge de trente-deux ans à Saïgon, et dont le corps n’a pas été rapatrié ; et le souvenir de l’épouse de l’administrateur colonial Striedter (entraperçue dans l’enfance), la « grande femme mortuaire » qui, en apparaissant, plonge Michael Richardson et Lol V. Stein dans le ravissement. Or Lol V. Stein, telle que Duras l’a campée, a éveillé en moi – lorsque j’ai lu le roman qui l’articule ; et quand je m’en ressaisis ou si ma mémoire la ressuscite –, une « figure » qu’elle active et remanie à la semblance d’un fantasme se réorganisant au fur et à mesure que le sujet dont il est habité s’échine à le « réaliser ».
Ce fantasme, quant à moi, quel serait-il ? Communier dans l’amour avec l’autre équivaudrait-il à me (re)trouver dans la mort avec l’autre, parce que dans le « tu es ma vie » qui me trotte dans la tête on peut entendre un « tu es moi » et aussi un « tuez-moi[7] » ? L’inceste comme gage d’un amour absolu – il innerve tout L’Amant – faufile cette adresse moulée et coulée dans le mortifère : « Tatiana, ma sœur, Tatiana[8]. »
Chez Duras, l’amour, comme le désir, est cannibale ; l’amant(e) – comme la religieuse, si elle est de l’ordre des insectes – dévore la femme aimée, sans tête (ni Max Ernst), dans un linceul d’abandon : « Il cache le visage de Tatiana Karl sous les draps et ainsi il a son corps décapité sous la main, à son aise entière. Il le tourne, le redresse, le dispose comme il veut, écarte les membres ou les rassemble, regarde intensément sa beauté irréversible, y entre, s’immobilise, attend l’engluement dans l’oubli, l’oubli est là[9]. » Dès Moderato cantabile, en 1958, désir et passion sont pris en écharpe par la pulsion de mort, n’oublions pas qu’Anne Desbaresdes exprime son désir d’être tuée à Chauvin ; et dans Hiroshima mon amour la formule « Tu me tues, tu me fais du bien » fait ritournelle… Duras lâche, dans Les Parleuses, avoir connu ce vertige : « je l’ai vécu ». Sans rabattre le texte littéraire sur le fantasme, on peut néanmoins alléguer que celui-ci est moteur, un des moteurs, de l’écriture, c’est ce que je retiens de L’Homme assis dans le couloir[10].
La « chose » (das Ding…), qu’on devine et suppute, fascine au point qu’on veuille la voir, l’épier, la revoir : l’étreinte dont on est exclu fait « scène primitive », elle renvoie à un voyeurisme de structure et à l’enfance, vraisemblablement à l’archaïque. L’absence à soi et aux autres – une sacrée béance –, mobilise le fantasme (lequel renouvèle et rectifie quelques traits, schémas, scénarios « primordiaux ») pour être (en partie – et par déplacements) provisoirement comblé. D’où la réitération de ce qui advient à Lol, à Richardson et à Stretter chez Tatiana, Hold et Lol. Le soir du bal et après, parce que la passion consume et enflamme, Lola Valérie Stein a flambé : comme une démente et une hystérique – comme une amoureuse. Dix ans plus tard, à son retour à S. Thala, son mari et Tatiana se demandent si elle est guérie, si elle ne s’embrasera pas de nouveau. Faut-il être folle (ou fou) pour entrevoir « la saloperie » au sein du désir, la pointe de jouissance dans le plaisir, le puits de mort qui creuse l’amour ? Tout au long de cette fiction, ce qui est poursuivi, ce n’est pas le jouir mais une plénitude délogeant le faire-semblant : « Dans un certain état toute trace de sentiment est chassée. Je ne vous aime pas quand je me tais d’une certaine façon. Vous avez remarqué ?[11] ». L’amour, en raison de sa réversibilité avec la haine, est une folie inextricablement liée à un élan de destruction – de soi et de l’objet de son désir –, dans la férocité envers l’autre.
Dans ce roman, Duras explore l’inévitable triangulation du couple lequel n’est jamais deux mais toujours trois, car entre les protagonistes interfère une tierce personne – revenante ou fantôme – et que c’est sa vérité, à l’exemple de ce qu’est la vérité de la langue vouée à n’être qu’un mi-dit (« Je dis toujours la vérité : pas toute, parce que toute la dire, on n’y arrive pas… Les mots y manquent… C’est même par cet impossible que la vérité tient au réel », Jacques Lacan). Il se pourrait que, près de quarante ans plus tôt, ce qui manque et manquera toujours à et dans la lettre du ravissement de Lol V. Stein, le surréaliste René Crevel l’ait esquissé dans son roman Babylone, prêtant à son personnage « L’Enfant qui devient femme » la question capitale à l’origine de tout chant, celui de Crevel comme celui de Duras : « Qu’est-ce que la mort ? Qu’est-ce qu’une putain ?[12] » C’est ce que fait résonner la voix de Marguerite Duras, laquelle renonce à dire et pourtant s’obstine à écrire. Cette voix est crépusculaire – crépusculaire, elle l’a toujours été, dans ses textes, dès les premiers, car, sa voix, elle se l’est faite, comme sa tête, une tête de vieille, alors qu’elle n’avait que dix-huit ou dix-neuf ans…
Ces remarques, si elles étaient pertinentes, éclairciraient-elles que, pour aimer, notamment quand on est un garçon hétérosexuel, il faille percevoir en l’autre, en l’être aimé, déchirure, fente et fissure et s’armer, comme Persée d’un bouclier ? Et faudrait-il en conclure que l’écriture est un creuset propice pour forger cet écu protecteur ?
Dans cette « affaire », si j’ose dire, je n’emprunte pas mon viatique à la seule Marguerite Duras. Un vers mélancolique d’Aragon me berce : On sourira de nous d’avoir aimé la flamme…Et si la langue un tant soit peu fourche, on peut entendre : « On sourira de nous d’avoir aimé la femme »… Parce que cette flamme et cette femme elles participent de ce qui trame l’existence et qu’il est difficile, sinon impossible de soutenir, de face, n’est-ce pas, le soleil ni la mort, ils ne se peuvent se regarder fixement, pourquoi, parce qu’on meurt toujours, dans tous les cas, soit d’un trop plein de vie, d’une vie de bâton de chaise, désordonnée et prédatrice, soit d’une vie à crédit, sacrifiée, où l’on économise sur tout et d’abord sur soi dans l’illusion de la conservation et de la pérennité, par quoi cette flamme est-elle alimentée, trop souvent c’est par la mort des femmes, celles qui se sont interdites de l’être, femmes, pour n’être plus que mères et épouses, et qui en ont été tuées.
Oui, cette flamme, c’est décidément la clé, le sexe et la mort ne se peuvent regarder fixement, sauf obliquement, dans un roman lequel sera inachevé – l’Histoire la littérature, des procès sans fin ni sujet, il ne peut en être autrement, cette sentence-ci « le sexe et la mort ne se peuvent regarder fixement » étant en outre plus juste, moins euphémique, que celle de La Rochefoucauld parce que le soleil y est le nom de la chose, l’astre du jour ou l’œil coupé en deux sur la ligne d’horizon, et ailleurs, sous le rasoir de Luis Buñuel et de Salvador Dali, ils sont la pulsion dans laquelle il faut trancher pour qu’advienne le désir, car sous l’hypocrisie de Tartuffe s’entend en effet la lâcheté du commun des mortels et des imposteurs : cachez ce sein, madame, cachez ce sexe, monsieur, que je ne saurais voir, puisque me tient en joue un basilic au bec venimeux et au regard meurtrier… D’entrée, je vous l’avais assuré, ce n’était pas forfanterie : Lol V. Stein, c’est moi, oui, c’est bien moi.
[1] Allusion à Marguerite Duras, Les Yeux verts, III, p. 679-680 : « Bresson est un très grand metteur en scène, l’un des plus grands qui aient jamais existé. Pickpoket, Au hasard Balthazar peuvent être à eux seuls le cinéma tout entier. [Tati], je l’adore absolument […]. Cependant, avec Tati, je me sens moins dans mon lieu que dans les films de Bresson. Bresson, ça va pour moi jusqu’à la douleur […]. Il faudrait instaurer cette critique-là : ne pas parler du film de façon intemporelle mais de soi devant le film. »
[2] Je partage le point de vue du psychanalyste Hervé Castanet quand il renvoie à Lacan à propos de la sexuation de l’espèce humaine : « Il y a certes la concrétude de l’anatomie mais la question de la sexuation c’est autre chose. Une anatomie de femme n’annule pas la question qu’est-ce qu’une femme ? – au contraire. C’est-à-dire que pour les sujets parlants que nous sommes, ‘Il n’y a aucune réalité pré-discursive. Chaque réalité se fonde et se définit d’un discours’, comme le rappelle Lacan – ‘le signifiant commande. Le signifiant est d’abord impératif. […] Il n’y a pas la moindre réalité pré-discursive, pour la bonne raison que […] les hommes, les femmes et les enfants, ça ne veut rien dire comme réalité pré-discursive. Les hommes, les femmes et les enfants, ce ne sont que des signifiants.’ » (in H. Catstanet, S.K.beau, Pourquoi l’art embarrasse-t-il le psychanalyste ?, Paris, éditions LCH-Compagnons, Collection « Présence », 2024, p. 340.
[3] Paru dans les Cahiers Renaud-Barrault, Paris, Gallimard, 1965, n° 52, p. 7-15 ; puis dans Marguerite Duras, [ouvrage collectif], Paris, Albatros, 1975, p. 7-15 ; et enfin dans Autres Écrits, Paris, Seuil 2001, p.191-197.
[4] Marguerite Duras, Le Ravissement de Lol V. Stein, (1964), in Œuvres complètes, T. II, Paris, Gallimard, Collection « La Pléiade », n° 573, 2011, p. 365.
[5] Jean-Michel Devésa, « Marguerite Duras : Le désir ou comment mourir vivant », [en ligne], Collatéral, 12 novembre 2024, https://www.collateral.media/post/marguerite-duras-le-d%C3%A9sir-ou-comment-mourir-vivant [consulté le 7 septembre 2025].
Ce texte reprend in extenso la communication présentée le 11 octobre 2024 dans le cadre de la VIe Biennale Marguerite Duras, organisée par l’Association internationale Marguerite Duras.
[6] Louis Aragon, « Cette vie est à nous », Le Roman inachevé.
[7] Marguerite Duras, Le Ravissement de Lol V. Stein, Op. cit., p. 350 [Hold à Tatiana] : « Tatiana tu es ma vie, ma vie, Tatiana. »
[8] Ibidem, p. 350.
[9] Ibidem, p. 356.
[10] Un récit bref de1958, publié sans signature dans L’Arc en 1962, et repris en 1980, en rapport avec la relation de 1956 à 1964 de Duras avec Gérard Jarlot, rencontré en 1955.
[11] Marguerite Duras, Le Ravissement de Lol V. Stein, Op. cit., p. 359.
[12] René Crevel, Babylone, (1927), Paris, Jean-Jacques Pauvert, 1975, p. 13.
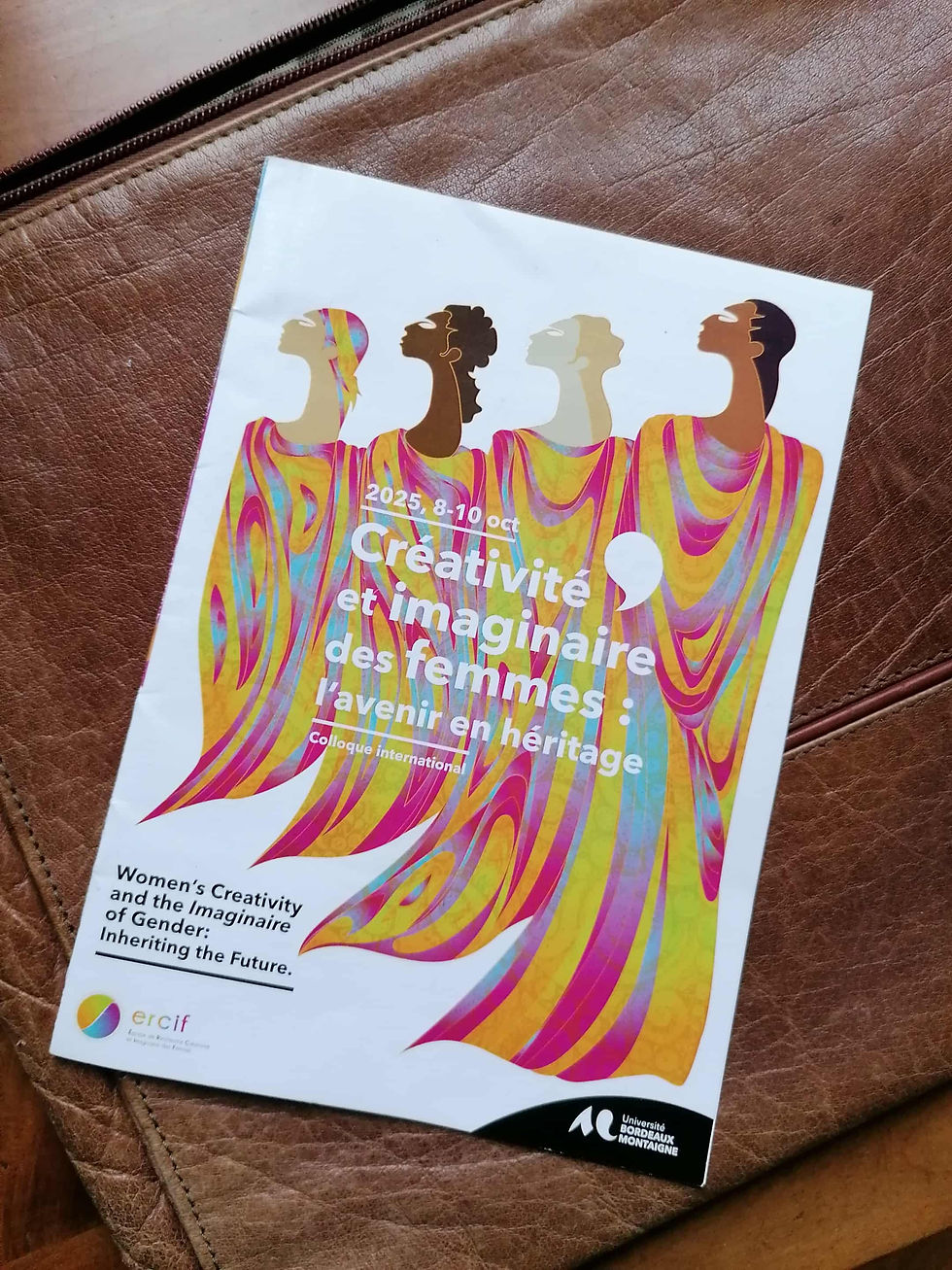






Commentaires